Sacré Douglas Kennedy ! C’est ce qu’on se dit en refermant la dernière page de L’homme qui voulait vivre sa vie.
Ben et Beth forment un couple en crise. Fin trentaine, chacun d’eux tisse des jours avec les fils épars de leurs rêves brisés. Beth nourrissait l’espoir de publier, mais après trois manuscrits refusés partout, elle a renoncé et se retrouve, malgré elle, femme au foyer. Ben voulait devenir photographe, mais les pressions familiales en ont plutôt fait un gestionnaire de patrimoine. Le pire scénario pour chacun d’eux. Et leurs frustrations ont mis du sable dans les rouages de leur vie de matrimoniale. Beth, surtout, s’éloigne hargneusement de Ben malgré les tentatives de celui-ci de réanimer l’amour. Pour tromper la réalité, le couple, financièrement aisé, se noie dans la surconsommation et l’alcool.
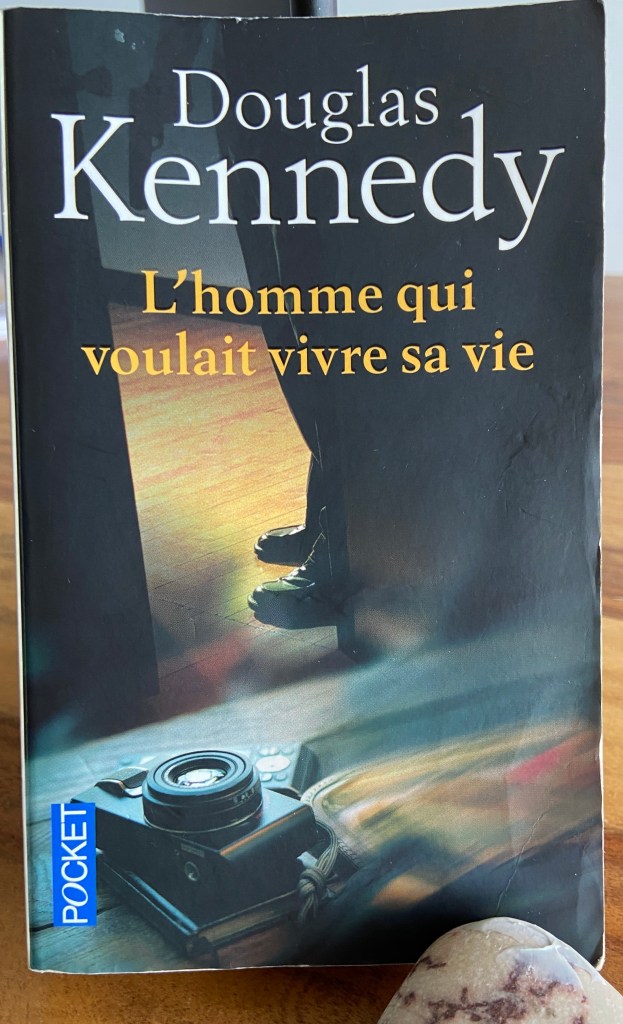
Voilà pour les 158 premières pages. On se demande un peu où veut en venir le narrateur, Ben en l’occurrence. Ça manque un peu d’action. Mais à la page 159, BANG ! Un geste impulsif, non prémédité, et nous voilà plongés dans un suspense haletant qui ne nous lâchera plus.
Je ne vous en dirai pas plus, sinon que ça parle des dégâts causés par les choix mercantiles ou les obstacles qui font voler en pièce l’idée qu’on se faisait de sa vie. La soif d’argent ou de célébrité s’en révèle les grands assassins. Tout ça dans une société américaine qui carbure à la réussite et qui dédaigne ceux et celles qui n’y sont pas encore parvenus.
Extrait
Les quelques jours qui ont suivi m’ont permis de mesurer la force redoutable de l’un des plus puissants truismes à l’œuvre dans la société américaine : une fois que vous êtes lancé, tout le monde vous veut. Dans notre culture, l’image de celui qui lutte pour arriver est intrinsèquement négative. D’emblée, on le catalogue comme un rien du tout, un raté s’exténuant à convaincre éditeurs, patrons de presse, producteurs, directeurs de galerie, agents et imprésarios qu’il aurait son mot à dire, si seulement on lui donnait la chance de s’exprimer. Mais personne n’a la moindre envie de lui accorder cette chance pour une raison bien simple : à quoi bon aider un minable à émerger de son anonymat mérité ? Quand bien même on lui reconnaîtrait un certain talent, la réaction habituelle est la peur : peur de faire confiance à son propre jugement, peur de se compromettre aux côtés d’une quantité négligeable.
De sa plume acérée et humoristique, Douglas Kennedy sait créer un récit palpitant tout en mettant au jour le canevas sociologique sur lequel se meuvent ses personnages. Du grand art !
Douglas Kennedy, L’homme qui voulait vivre sa vie, Pocket, 1998, 497 pages





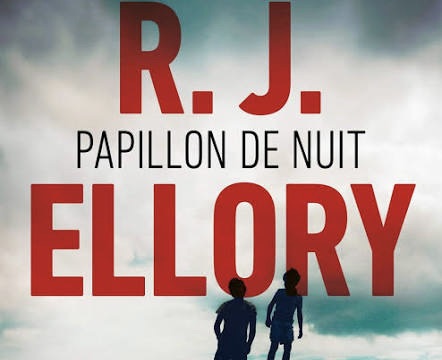
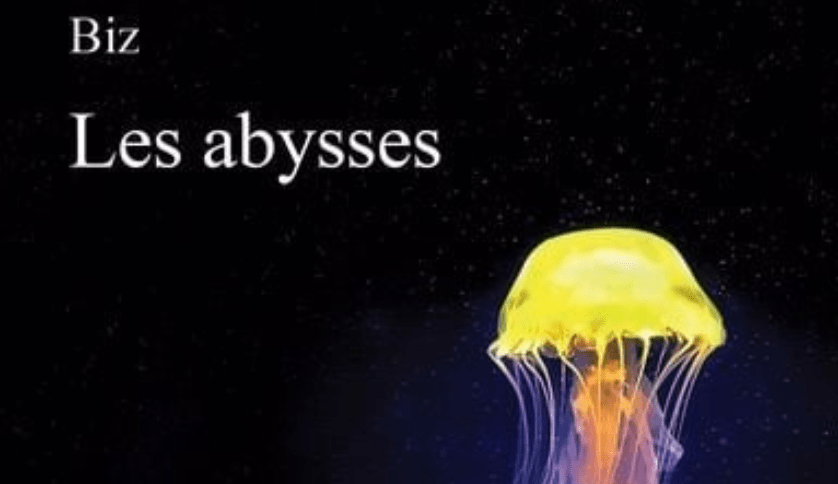
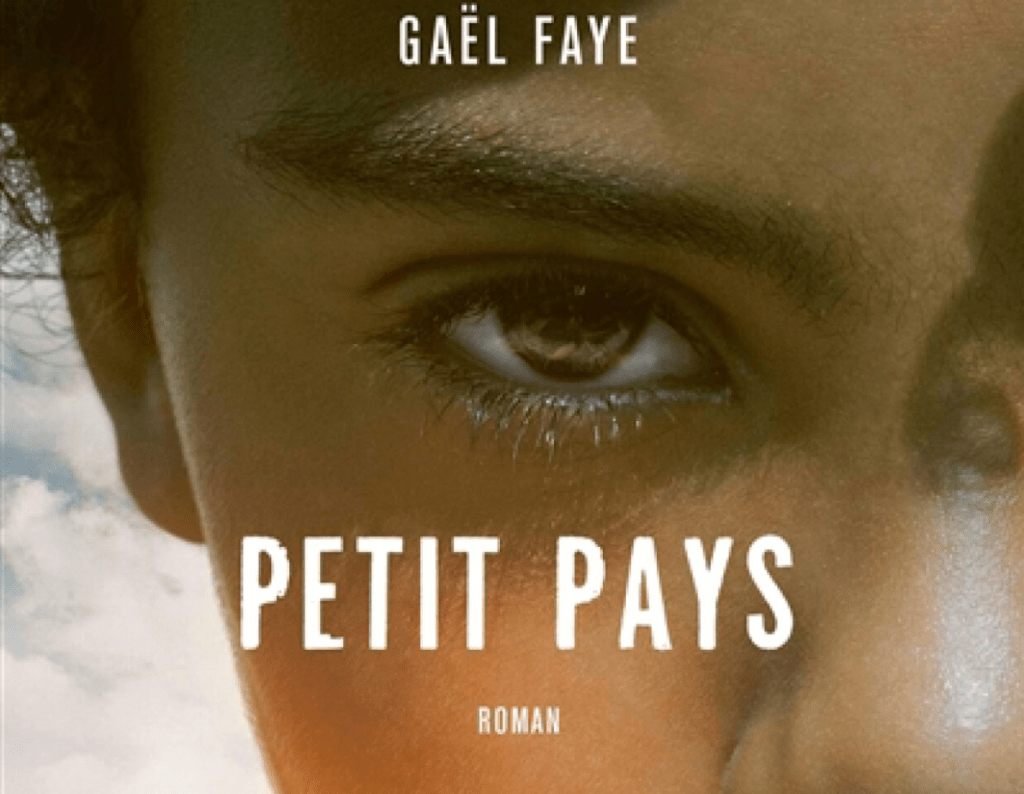
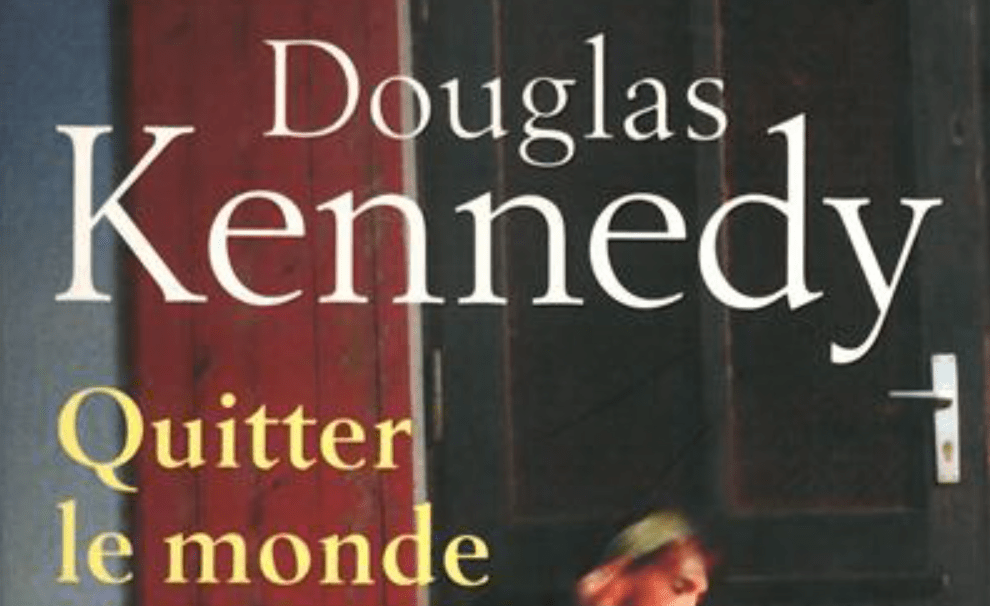
Laisser un commentaire