Quel bon choix que ce roman de Douglas Kennedy, Quitter le monde, comme lecture de voyage. D’abord parce qu’il est volumineux à souhait et que, malgré peut-être quelques longueurs, le suspense et les rebondissements nous gardent en haleine.
Le propos
Le soir de ses 13 ans, Jane déclare à ses parents, qui viennent de se disputer pour la énième fois, qu’elle ne se mariera jamais et n’aura pas d’enfant. Peu de temps après, le père de Jane abandonnera femme et enfant et la mère en mettra la faute sur la déclaration colérique de la jeune fille. La vie de Jane en sera irrémédiablement marquée. Sentiment d’abandon – bien réel d’ailleurs – , culpabilité induite par une mère névrosée, pèseront sur les choix de vie de Jane.
Le temps a passé. Jeune femme pleine de talents, Jane est admise à Harvard et obtient qu’un prestigieux professeur supervise sa thèse de doctorat. S’en suit une relation amoureuse secrète dont la fin abrupte commencera à ébranler les assises déjà chambranlantes de la jeune femme. Le risque que cette relation soit mise au jour poussera Jane à accepter un poste d’enseignante dans une université de troisième ordre. Et comme si le destin s’acharnait sur elle, les drames s’accumuleront dans sa vie, dont une mort tragique, la poussant à fuir de nouveau, de plus en plus loin, de plus en plus meurtrie et sauvage. Fuite d’une culpabilité sans fond. Culpabilité et rage. Malgré qu’elle repousse toute tentative d’aide, de soutien, de compassion, les innombrables manifestations d’empathie, les mains tendues, finiront par percer la carapace de Jane et… je n’en dis pas plus.
Extrait:
Le soir de mon treizième anniversaire, j’ai fait cette déclaration: «Je ne me marierai jamais et je n’aurai jamais d’enfants.
Je me rappelle encore les circonstances exactes de cette annonce. Il était environ six heures du soir à New York dans un restaurant au croisement de la 63e Rue Ouest et de Broadway, c’était le 1er janvier 1987, et mes parents venaient de se lancer à nouveau dans une dispute. Attisée par l’alcool et une impressionnante accumulation de griefs soigneusement refoulés, la scène de ménage publique avait pris fin quand ma mère, après avoir hurlé que mon père était une ordure, s’était enfuie en pleurant dans les toilettes des dames, qu’elle continuait à appeler «le petit coin». Et si les autres convives étaient restés bouche bée devant ce bruyant étalage de frustration conjugale, moi, il ne m’avait guère surprise.
On se dit par moments que Kennedy en a fumé du bon lorsqu’il a concocté cette histoire tant la trajectoire de son héroïne est inattendue et chaotique. Mais on comprend que l’acharnement de Jane à saboter sa vie n’est rien d’autre que le reflet de l’étendue des dégâts infligés par des parents déficients. Elle suscite en nous à la fois de l’impatience et de l’attachement. On voudrait la battre et la prendre dans nos bras.
La plume de Kennedy ne me déçoit jamais. J’adore son humour ironique, son regard caustique et sa vaste culture. Peut-être pas son plus grand roman, mais un vrai plaisir de lecture.
Douglas Kennedy, Quitter le monde, Pocket, 2010, 693 pages

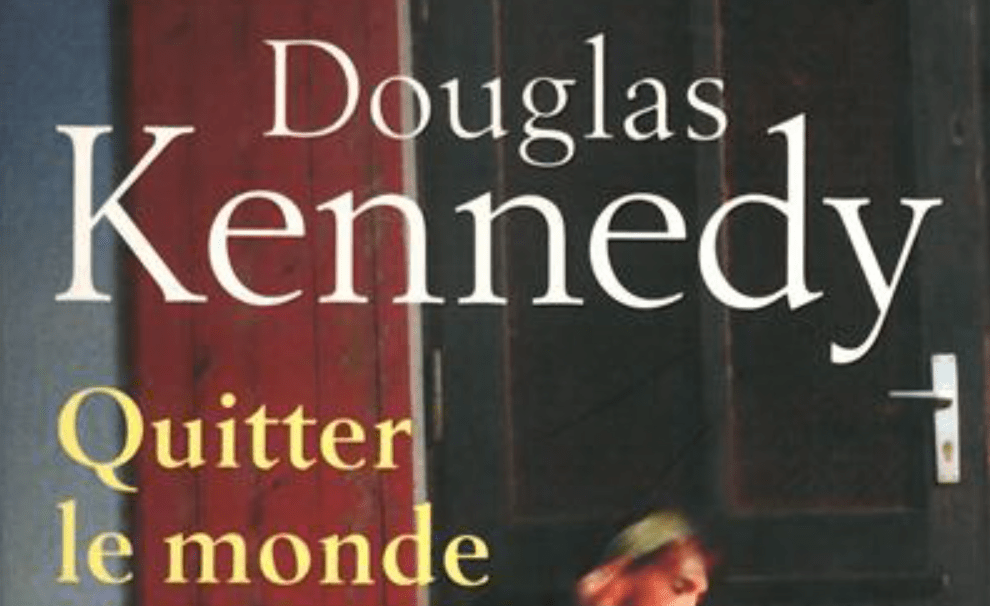



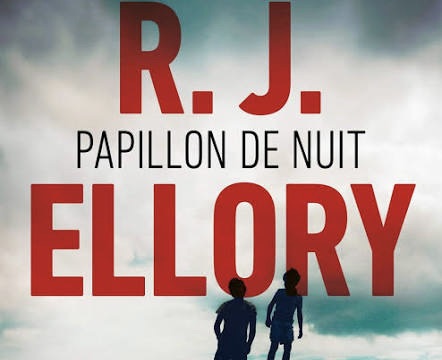
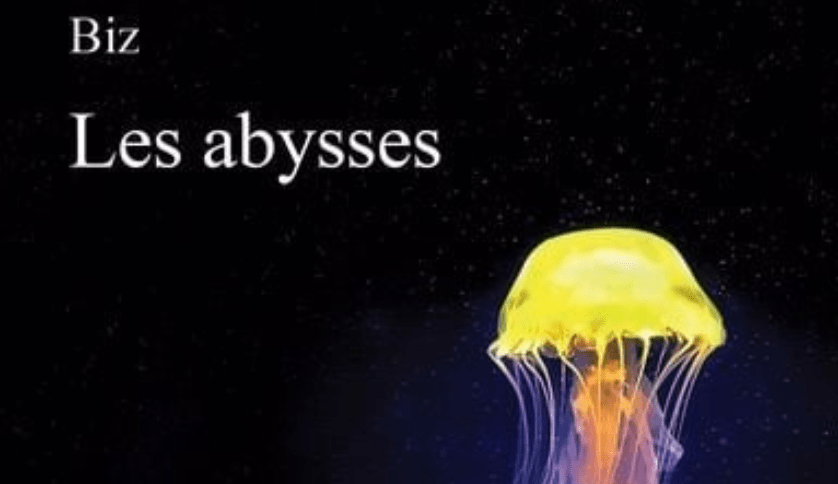
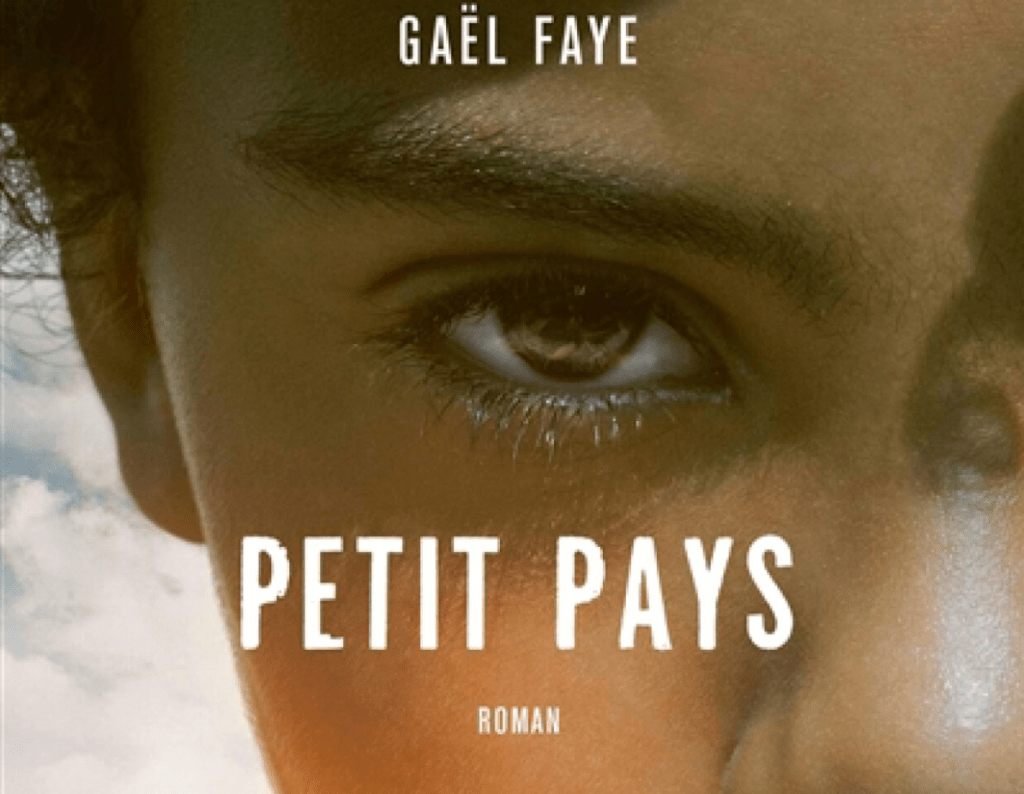
Laisser un commentaire