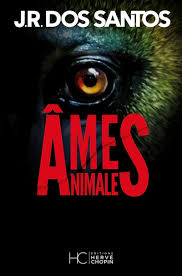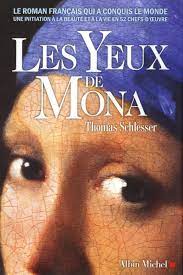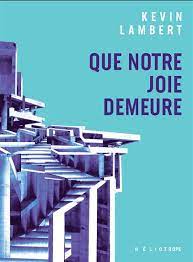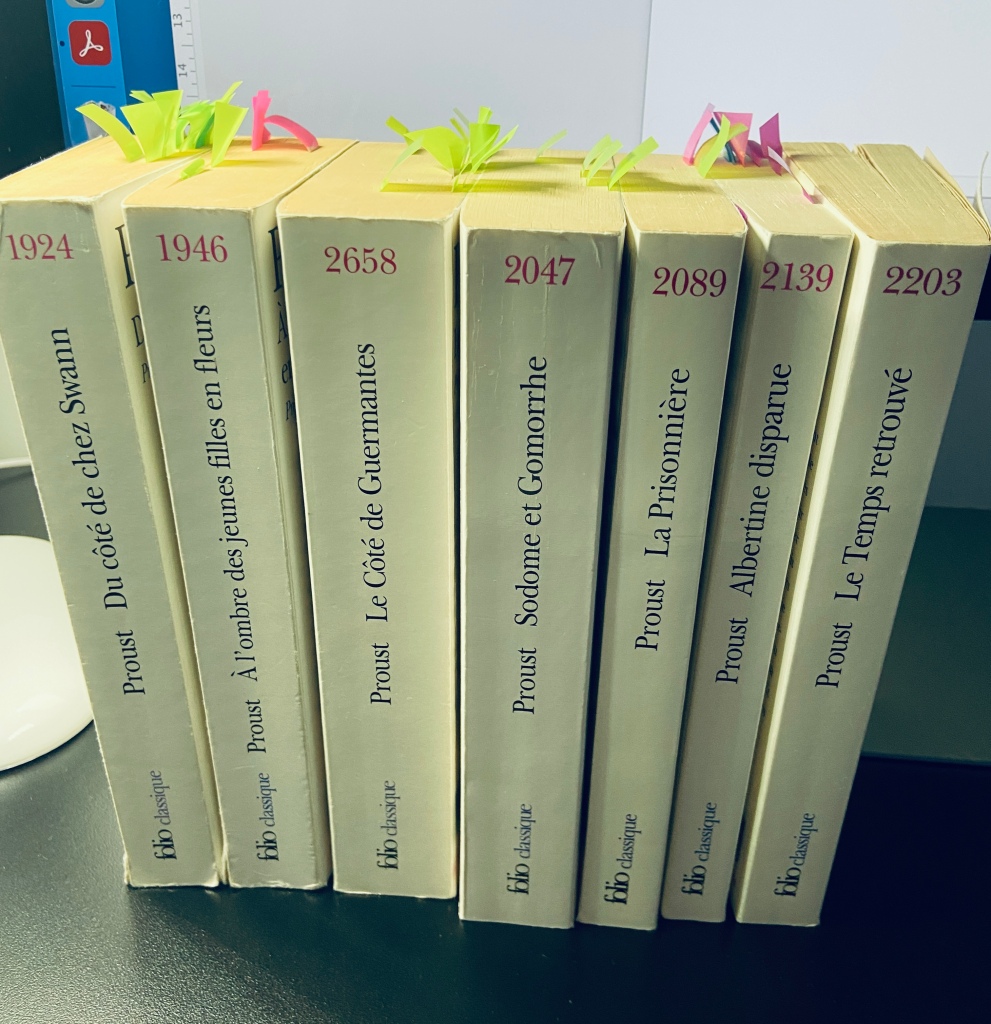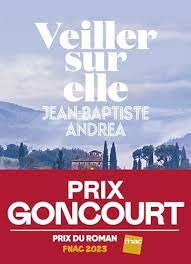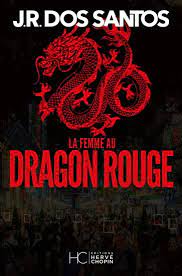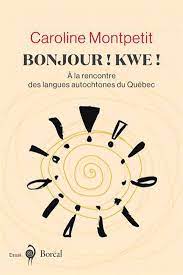Une biographie et une fiction nous parlent de femmes et de désir. Dans l’ordre de lecture, La vie de ma mère, de Nathalie Petrowski, dessine à grands traits la vie de Minou Petrowski qui fut une personnalité flamboyante de la vie culturelle québécoise. Histoire d’amour inconditionnel d’une petite fille pour sa mère mais que la maturité lui fera voir dans un dégradé de sentiments souvent contradictoires. Moins un règlement de compte qu’un instant de pause de l’auteure pour comprendre la femme complexe que fut sa mère et l’empreinte qu’elle a laissée sur sa propre vie.
Suivre ses désirs, ne jamais laisser personne nous freiner dans nos élans, se foutre des conventions, n’en faire qu’à sa tête en suivant son cœur et son corps, vivre librement sans contraintes : voilà ce que le voyage en Californie de ma mère m’a appris. Il m’a aussi appris que la fidélité, pour une femme mariée, était une valeur désuète et que tromper son mari n’était pas interdit. Une femme avait le droit de vivre sa vie et d’avoir des aventures d’un soir ou même de deux ou trois. Pourquoi s’en priver ? La vie était courte, il fallait en profiter.
C’était avec cette notion de liberté à tout crin que j’ai entrepris ma vie de jeune adulte. Ce fut une période de grande confusion, de perte de repères, d’égoïsme débridé et d’inquiétante instabilité. J’étais peut-être libre, mais je nageais en plein chaos. Et surtout, j’étais malheureuse comme les pierres. p. 82
La vie de ma mère est un petit bouquin qui se lit tout d’un trait. Il est toujours intéressant d’aller à la rencontre d’êtres marginaux et ardents comme Minou et sa fille Nathalie.
Nathalie Petrowski, La vie de ma mère, Les éditions La Presse, 2023, 134 pages
***
Anaïs Barbeau-Lavallette, auteure du magnifique livre La femme qui fuit, livre, dans une fiction sous forme d’un long poème en prose, une histoire d’amour et de désir incandescents. Les frontières fictives de Femme fleuve sont poreuses laissent pénétrer des faits connus de la vie de l’auteure. C’est l’histoire d’un peintre et d’une écrivaine qui se retirent dans une villégiature insulaire pour y pratiquer chacun leur art. Et dans ce lieu qui flotte hors du temps et hors de la vie de famille de chacun, ces deux êtres se rencontrent et flambent de désir et d’amour. Le fleuve qui les isole, qui leur fait un cocon, aura-t-il le dernier mot ? Ou retourneront-ils chacun à leur amour et à leurs enfants ancrés sur la terre ferme.
Une femme plonge devant nous. Elle est aspirée par le fleuve, qui efface la trace de son passage. Plus aucun cercle ne parle d’elle, la surface de l’eau retrouve ses plis initiaux, la lourde couverture fluviale cache la pêcheuse, qui devient un secret.
Mon cahier reste déplié comme un corps offert, il attend que j’y couche mes mots. Je voudrais écrire le fleuve mais c’est toi qui m’absorbes.
Tu ne voles pourtant pas la vedette à aucun élément du paysage : naturellement humble, tu t’accordes à ce qui t’entoure. Tu possèdes la même dignité intérieure que le territoire, tu partages sa mélancolie.
On dirait que je te connais depuis très loin. Quelque chose au centre de toi me donne envie de te fêter. p. 44
La trame du récit est légère mais la parole est dense, belle. Une lecture méditative et apaisante.
Anaïs Barbeau-Lavallette, Femme fleuve, Éditions Marchand de feuilles, 2022, 252 pages