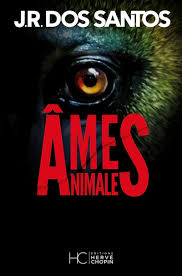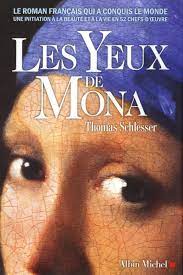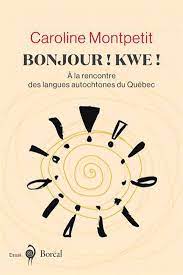Je ne me lasse pas de lire John Grisham. Un grand nombre des romans de cet auteur, avocat de formation, portent sur une vision différente de la justice. Pas celui-ci. La chance d’une vie est plutôt le prétexte à mettre dos à dos la misère la plus sordide et l’extrême richesse et le risque inhérent à chacun de ces univers. Le contraste est percutant, ébranlant.
Le propos
Samuel Souleymon pratique le basket dans son petit village d’un Soudan du Sud où règnent la guerre civile, la pauvreté et la précarité. Mais il est doué et il est remarqué par un Américain d’origine soudanaise qui revient chaque année dans son pays natal pour dépister les talents. Samuel, que ses amis américains rebaptiseront Sooley, vivra au cours d’une seule année une ascension vertigineuse et tragique en migrant de sa hutte aux palais rutilants de South Beach et à sa faune décadente. Durant ce temps, la guerre frappera les siens, sa famille sera décimée et les survivants, sa mère et ses deux petits frères, réussiront à se réfugier dans un camp de l’Ouganda.
Un commentaire
J’ai adoré ce roman. Grisham maîtrise l’art du récit. Son écriture est simple et terriblement efficace. Il décrit les faits, sans fioritures, des faits qui parlent par eux-mêmes. Il sait donner vie à des personnages attachants, crédibles. On a l’impression d’une biographie plutôt que d’une fiction. Et cette histoire rend plus concret ce qui se passe au Soudan et, par extension, dans tous les pays en guerre, dans tous les camps de réfugiés.
L’échantillon
Le dimanche, en fin d’après-midi, quand le bus arriva sur le campus de Central, les étudiants attendaient leurs héros. Au bord de la route, ils applaudissaient à tout rompre, brandissaient des pancartes et jetaient des confettis. Devant le Nid, des barricades avaient été installées pour protéger les joueurs et les entraîneurs, qui descendirent sous les hourras de leurs fans. Une demi-douzaine de vans de télévision étaient garés n’importe comment et les caméras semblaient partout. À l’intérieur, c’était la folie : quatre mille étudiants et supporters remplissaient les tribunes et le terrain. Tous attendaient l’équipe qui, pour la première fois de l’histoire de l’université, faisait partie du carré magique : le Final four. Quand Mitch les conduisit à travers le tunnel pour réapparaître au cœur de la foule, le chant familier de « Soley ! Soley ! Soley ! » résonnait dans le vieux gymnase. P. 289
Un autre petit bijou du grand John Grisman
John Grisham, La chance d’une vie, JC Lattès, 2022, 389 pages